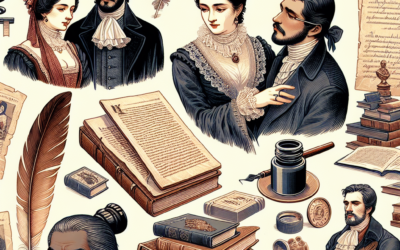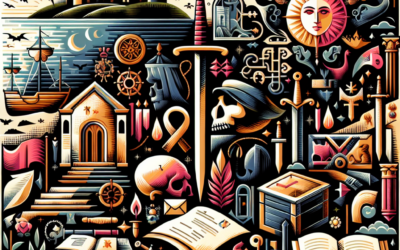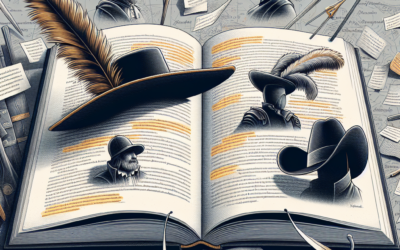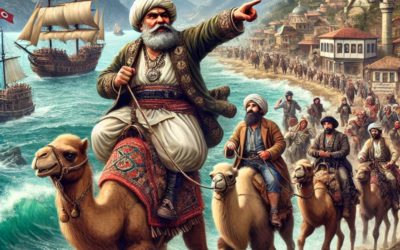Focalisation : qui parle, qui voit, et pourquoi c’est politique
Ok par exemple la voix narrative test du site.
Pourquoi la focalisation nous concerne tous
Aujourd’hui, tout est affaire de point de vue. Dans une époque saturée d’images, de récits éclatés, de fake news et de storytelling politique, la focalisation n’est plus seulement une affaire littéraire, c’est une mécanique de pouvoir. Qui décide du point de vue à adopter dans un roman ressemble étrangement à ceux qui contrôlent le récit dominant dans nos sociétés. Écrire, lire, interpréter : chaque geste est politique.
Dans cet article, nous allons décortiquer le principe de focalisation en littérature, puis nous ouvrirons la boîte noire pour saisir ce qu’il dit de notre manière de représenter le monde. Car la narration n’est pas neutre, et le choix de qui voit et qui parle n’est jamais innocent.
Les trois types de focalisation
Gérard Genette, théoricien littéraire, a proposé une classification du phénomène de focalisation dans sa célèbre Figure III. C’est toujours un bon point de départ, même si, vous verrez, les étiquettes craquent vite quand on pousse un peu la réflexion.
Focalisation zéro
C’est le récit omniscient. Le narrateur sait tout, voit tout, entend tout. Il connaît les pensées des personnages, voit la scène de n’importe où, et n’est limité par aucun filtre subjectif. Il plane au-dessus, tel un dieu cruel ou bienveillant.
Ce type de focalisation était dominant dans le roman du XIXe siècle : Balzac, Zola, Hugo. Mais attention : ce n’est pas parce que le narrateur sait tout qu’il est neutre. Il impose son regard totalisant, souvent une vision du monde bourgeoise, patriarcale, coloniale.
Focalisation interne
Ici, la narration est filtrée par un personnage. On voit ce qu’il voit, on connaît ses pensées, ses sensations, ses jugements. Mais on ne sait pas ce que pensent les autres. C’est comme une caméra greffée au cerveau du personnage.
La focalisation interne crée de l’empathie, de l’introspection. C’est le royaume du roman psychologique, de Flaubert à Camus. Mais là encore, ce choix n’est pas neutre : qui mérite d’être exploré de l’intérieur ? Quel personnage est assez « intéressant » pour qu’on lui prête notre conscience ?
Focalisation externe
La narration se limite à ce qu’un observateur extérieur pourrait percevoir : comportements, gestes, dialogues. Aucune pensée intérieure, pas d’émotion explicite. L’écriture devient quasi cinématographique.
C’est la méthode du nouveau roman, d’Alain Robbe-Grillet notamment, ou encore celle de Hemingway et du courant behavioriste. Mais ce style soi-disant objectif est une illusion de neutralité. Ce qu’on voit (et ce qu’on ne voit pas) construit subtilement une vision du monde froide, désincarnée, parfois même inhumaine.
Focalisation et pouvoir
La focalisation, c’est une prise de contrôle du regard. On décide qui a accès à quel morceau de réalité, et par quel prisme. Cela crée une hiérarchie invisible entre les personnages, mais aussi entre l’auteur, le lecteur, et le monde mis en scène.
« Toute narration est une lutte pour imposer un point de vue. Le reste n’est que décor. »
— Anonyme désabusé (ou lucide)
Focalisation et invisibilisation
Quand certains personnages — souvent des femmes, des Noirs, des minorités — apparaissent uniquement vus de l’extérieur, sans accès à leur intériorité, il ne s’agit pas d’un oubli. C’est un choix de focalisation. Or, qui n’a pas d’intériorité n’est pas tout à fait humain dans le récit.
Faire parler un point de vue dominé, c’est déjà une révolution littéraire.
Contre-focalisation et réappropriations du regard
Nombreux sont les écrivains contemporains qui déconstruisent aujourd’hui la focalisation dominante. Ils écrivent depuis des marges, depuis le regard des opprimés, des corps souffrants ou revoltés. Ils brouillent les repères, mélangent la première personne et la focalisation externe, multiplient les voix narratives.
Ces procédés servent un projet clair : reprendre en main le regard, casser la transparence du récit classique. Rendre visible ce qui ne l’est jamais.
La focalisation n’est pas seulement littéraire
Ce qu’on appelle focalisation en littérature existe dans tous les récits, sous toutes les formes : films, jeux vidéo, publicités, discours politiques. À chaque fois, nous sommes placés quelque part. L’œil n’est jamais neutre.
- Qui a le droit de raconter une histoire ?
- À travers quel prisme la guerre, l’amour, la pauvreté sont montrés ?
- Pourquoi focalise-t-on toujours sur le héros blanc hétérosexuel ?
Même les réseaux sociaux sont des machines à focalisation. Ce qu’on voit dépend d’un algorithme, c’est-à-dire d’un Dieu numérique qui choisit pour nous où regarder.
C’est pourquoi comprendre la focalisation, ce n’est pas juste mieux lire Proust, c’est aussi désapprendre à être spectateur passif.
Renverser la caméra
Dans le cinéma féministe, on parle de male gaze : ce regard masculin qui sexualise et objectifie les femmes à l’image. C’est une question de focalisation : qui regarde, et comment. Renverser la focale, c’est subversif.
Alors que faire ? Voici quelques pistes essentielles pour désapprendre les focalisations prédéfinies :
- Lire à rebours : repérez qui est vu et qui regarde dans les textes. Débusquez les silences, les angles morts.
- Refuser le confort du regard stable : plongez dans les textes polyphoniques, ambigus, fragmentaires.
- Faire parler ceux qu’on ne montre jamais : écrivez, faites écrire, transmettez d’autres points de vue.
La théorie littéraire est puissante quand elle sert à résister. Comprendre la focalisation, c’est apprendre à voir autrement, et à ne plus croire que la vision dominante est naturelle.
Conclusion : voir, c’est choisir
La focalisation est l’un des outils les plus puissants de la narration. Elle décide de ce qui est montré, pensé, vécu. Et cette décision n’est jamais innocente. Elle fabrique nos perceptions, nos croyances, notre rapport aux autres.
Dans un monde qui nous inonde de récits, apprendre à repérer la focale, c’est se rendre un peu plus libre. Ne soyez pas l’œil qui subit. Soyez celui qui déplace la caméra.